Formé à la linguistique à l’École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales, Jean-Pierre Martinez a participé dans les années 80 aux travaux de l’École de Paris, dirigée par Algirdas Julien Greimas, en tant qu’animateur, avec Jean-Marie Floch, de l’Atelier de Sémiotique Publicitaire du Centre National de la Recherche Scientifique. Il a parallèlement exercé pendant plus de vingt ans comme sémiologue consultant pour les plus grands instituts de conseil, notamment Ipsos. Cette page propose quelques articles publiés par Jean-Pierre Martinez sur ces sujets, dont certains inédits.
Le string et le voile. CB News n°776, février 2004.
Le degré zéro de la communication. CB News n°825, 7 mars 2005
Temps de cœurs disponibles. CB News n°818, janvier 2005.
Ogilvy, Seguéla, Feldam, Michel… Stratégies, n°477, juin 1985.
Système de croyance et crédibilité publicitaire. Actes sémiotiques, IX,37. Mars 1986.
Être, paraître, transparaître. Contrôle, revue de l’Autorité de sureté nucléaire, n°141 juillet 2001.
De l’arbitraire du signe au symbole de l’arbitraire. Mars 2004
Sémiologie de la burqa : signe, symbole, indice ou signal ? Octobre 2010.
Un vrai calvaire. Mars 2005
Création : de la profondeur à la surface. Juin 2006
N’oubliez pas les paroles, un vrai conte de fées. Janvier 2020.
Le string et le voile
Le libertinage comme justification ultime de l’intégrisme, par Jean-Pierre Martinez, sémiologue. Paru dans CB News n°776, février 2004.
 Doit-on brûler les publicitaires ?
Doit-on brûler les publicitaires ?
Il y a quelques années, une affiche publicitaire pour les strings Boléro faisait scandale. On y voyait une jeune femme, de dos, baissant son short pour exhiber son postérieur, tout en interpellant le passant : « Je suis vierge. Et vous ? ». À y regarder de plus près, les moins myopes comprenaient que la ligne de strings Astro déclinait les douze signes du zodiaque. Choquante, cette pub ? En tout cas, parfaitement classique dans son mode opératoire, et remarquablement efficace quant à son résultat. L’affiche pour Boléro fonctionne en deux temps. Une accroche à la fois « impactante » et mystérieuse (les fesses en dévoilement et la question en suspens), conduisant inéluctablement le spectateur à satisfaire sa curiosité émoussée en lisant le message en bas de page (« Le premier string avec ton signe astrologique en hologramme »).
Cette mécanique publicitaire est plus généralement celle de la séduction en tant que manipulation, consistant à créer le manque pour attiser le désir de consommation. Si l’on ajoute que dans le jargon franglais des publicitaires, l’accroche-mystère s’appelle un « teaser » (et le message-réponse une « base line »), on aura compris que la publicité utilise les mêmes ficelles que le strip-tease. Il suffit, pour s’en convaincre, de se rappeler la célèbre campagne de promotion… de la publicité elle-même, dans laquelle une jeune femme dénommée Myriam, après avoir enlevé le haut, promettait d’ôter bientôt également le bas, mettant ainsi toute la France en haleine. Elle tint parole quelques jours plus tard en utilisant cependant une pirouette, au sens propre, puisque, s’étant retournée, elle ne nous montrait finalement que… ses fesses. Ce tour de passe-passe résumait parfaitement l’essence même d’une manipulation publicitaire ayant au moins le mérite de s’afficher franchement, avec humour, comme telle : je vous mène par le bout du nez en vous promettant la lune, mais je ne vous montre finalement que mes fesses…
En 1981, donc, peu de temps après la victoire de François Mitterrand, élu à la suite d’une autre fameuse campagne de publicité (La Force Tranquille), Myriam, aujourd’hui considérée comme pionnière d’une certaine libération des moeurs, était interdite d’affichage dans de nombreuses villes, dont celle du premier Premier Ministre de la gauche. Quelques années avant Myriam, pourtant, les premières féministes enlevaient elles aussi le haut lors des meetings d’un certain Jean Royer, maire de Tours, grand protecteur de la pudeur, des femmes et des embryons. Autre temps, autres moeurs…
La publicité Boléro, pour sa part, constitue un ultime blasphème en associant cet artifice diabolique qu’est le string, d’une part à l’astrologie (c’est-à-dire à une forme de croyance métaphysique), et d’autre part à la virginité féminine (valeur, comme on le sait, vénérée par la plupart des religions). Si l’on considère que montrer ses fesses (comme tirer la langue) est pour le moins une insolence, la publicité Boléro est bien, en effet, un pied de nez à la morale et à la religion.
 Faut-il légiférer contre le port du string ?
Faut-il légiférer contre le port du string ?
Doit-on pour autant brûler tous les publicitaires, et leurs modèles libertins, comme au Moyen Âge on brûlait les sorcières ? Certains militants anti-pub ne semblent pas loin de le penser, soutenus en cela par une récente initiative gouvernementale visant à mettre à la disposition du grand public un numéro de téléphone pour recueillir les réactions face aux « atteintes à l’image des femmes dans la publicité ». Cet appel à la vigilance morale et à la délation publique fait écho, entre autres, à la récente proposition de loi d’un député UMP visant à créer un nouveau « délit d’atteinte à la dignité de l’homme et de la femme par l’image publicitaire ». Dans l’exposé des motifs, on nous explique que cette proposition de loi est destinée à protéger les français des messages subliminaux et libidineux auxquels ils sont exposés quotidiennement, malgré eux, par des publicitaires (forcément) déviants. Le premier pas vers l’instauration d’une censure préalable… ou les prémisses d’un grand retour aux affaires des puritains et de l’inquisition ?
Pour être conséquent, d’ailleurs, si l’on projette de censurer la publicité destinée à promouvoir le string, ne devrait-on pas tout simplement interdire le string lui-même ? À l’école, en tout cas, où il se donne souvent ostensiblement à deviner au dessus de la ceinture du pantalon d’adolescentes visiblement déjà possédées par le démon de la consommation. En d’autres termes, faut-il légiférer contre le port du string dans la mesure où il attente, si ce n’est à la laïcité, du moins à la dignité de la femme qui le porte, certes de son plein gré, mais sous l’irrésistible pression d’une gente masculine fanatisée par les prêches enflammés de publicitaires sataniques ?
Ces nouveaux puritains partisans de telles fatwas parlementaires sont-ils aussi chatouilleux quant aux atteintes à la laïcité ? Quoi qu’il en soit, mettre sur le même plan, en les opposant, le « problème » du string et celui du voile, fournit un argument de poids à l’intégrisme, qui a beau jeu de dénoncer un paradoxe apparent. Puisque le string (ou encore le piercing mal placé, et plus généralement l' »érotisation de l’environnement » dénoncée par notre député censeur), bien qu’attentatoire à la dignité de la femme, reste toléré, pourquoi le voile, qui n’aurait finalement pour but que de préserver la pudeur féminine, devrait-il être interdit ? Mieux encore, si les filles doivent porter le voile, c’est finalement aussi pour se protéger d’agressions sexuelles rendues plus probables par les appels aux viols des publicitaires. Tant qu’on n’aura pas interdit le string et la publicité dépravée qui va avec, le voile restera donc nécessaire comme juste contrepartie.
L’esprit libertin deviendrait ainsi le justificatif ultime de l’intégrisme liberticide. On ne pourrait venir à bout du deuxième qu’en remettant en cause le premier, et pour faire passer la pilule de l’interdiction du voile, il faudrait aussi condamner le string comme signe ostensible d’adhésion à l’esprit de débauche ambiant. La laïcité ne pourrait donc triompher qu’au prix d’un retour à l’ordre moral. Une certaine gauche, d’ailleurs, n’est pas en reste quant à ces raisonnements par l’absurde dont elle s’est fait une spécialité. A quoi bon lutter contre l’intégrisme tant qu’on aura pas réglé le problème de l’intégration ? Une justification de l’inaction qui en rappelle d’autres. A quoi bon réprimer la délinquance tant qu’on aura pas assuré l’égalité des chances ? On sait ce que cette vertueuse rhétorique de l’impuissance a coûté à la gauche et à la France un certain 21 avril…
Le 21ème siècle sera-t-il vraiment religieux ?
Au-delà, donc, du clivage droite-gauche, on assiste aujourd’hui à l’alliance objective d’une partie (majoritaire ?) de la classe politique et de l’électorat autour d’une certaine idée de l’ordre moral et de la place réservée aux femmes dans cet ordre restauré. Toutefois, même si ces deux oppositions sont étroitement corrélées, il s’agit moins ici d’un antagonisme entre laïcs et religieux, que d’une confrontation entre d’une part les tenants d’une morale absolue et figée, car inscrite dans une nature des choses dont il faut à tout prix préserver l’intégrité, et d’autre part les tenants d’une morale relative et évolutive, car inscrite dans une histoire culturelle dont il convient de ne pas empêcher le progrès (tout en se gardant d’éventuelles dérives).
Très en vogue, la notion de « développement durable » constitue d’ailleurs une tentative de synthèse générale entre un libéralisme total, à la fois matériel et moral, évidemment autodestructeur, et un conservatisme intégral, combinant malthusianisme économique et néo-puritanisme, pour rassembler finalement les opposants à toute évolution (anti-mondialistes, anti-OGM, anti-nucléaire, anti-pub… mais pas vraiment anti-cléricaux). Il n’est donc pas surprenant que certains soient tentés par un écologisme de la pensée, qui seul autoriserait un développement durable des bonnes moeurs.
La notion de laïcité, en revanche, n’apparaît pas aujourd’hui, pour bon nombre d’intellectuels, comme suffisamment moderne pour mériter d’être défendue. Pas assez à la mode. Trop poussiéreuse. Sentant trop sa Troisième République et son instituteur début de siècle. Il est de bon ton, pour se démarquer de ce qui semble bien malgré tout, en France, être un large consensus en faveur de l’interdiction du port ostensible de signes religieux à l’école et dans les services publics, de dénoncer une laïcité intégriste, qui ferait fi des libertés individuelles, en l’occurrence confessionnelles.
Une partie du monde, pas seulement musulman, s’élève contre cette nouvelle révolution française (dont Chirac serait le Robespierre), osant proclamer que la loi de la République doit primer sur celle de toute autre communauté qui prétendrait s’en affranchir de droit divin et plus généralement par nature. Faut-il vraiment être gêné que le pays inventeur des Droits de l’Homme réaffirme ses principes en matière de laïcité, au risque d’être désavoué, y compris par les États-Unis ?
Il est vrai que le modèle américain du « melting pot » est très différent du centralisme jacobin à la française. Les États-Unis ne sont pas seulement une fédération d’états mais aussi de communautés. On n’y recherche pas l’assimilation, mais l’union autour d’un contrat social (le rêve américain), économique (le mythe libéral) et politique (un pouvoir fédéral) réduit au plus petit commun diviseur. Aucun risque de séparatisme ou d’éclatement dans cette entité agrégative que sont les États-Unis, fondant sa cohésion sur l’exercice d’une puissance dominante et la reconnaissance constitutionnelle d’un Dieu multiconfessionnel (In God We Trust), sorte de clé universelle des religions, postulant leur nécessité naturelle. Faire allégeance à tous les dieux ou n’en reconnaître aucun, tel serait donc l’alternative incontournable pour assurer la cohésion nationale. Compte tenu de son histoire et de ses réalités actuelles, la France est en droit de choisir une voie qui lui soit propre, en réaffirmant le principe de séparation des églises et de l’état.
Touche pas à mon string !
L’histoire a maintes fois montré, hélas, ce que la primauté du sentiment d’appartenance ethnique et/ou religieuse peut engendrer comme déchirements. L’ère des grands affrontements idéologiques d’ordre philosophico-politique étant révolue, il serait en effet difficile de trouver aujourd’hui un seul conflit dans le monde qui ne soit structuré en profondeur par une revendication identitaire et communautariste. Même en Iraq, le pouvoir de Saddam reposait sur la domination d’une communauté (et d’une tendance confessionnelle) sur les autres, et la gestion de l’après-guerre reste organisée autour de ces divisions.
Pour tous ceux, cependant, qui rejettent l’idée d’un monde à tout jamais figé dans la contemplation de ses lois plus ou moins divines mais quoi qu’il en soit éternelles, la différence entre le string et le voile se doit d’être soulignée. Nul, homme ou femme, n’est contraint de porter un string « par nature ». Le string ne catégorise pas définitivement le monde (en distinguant notamment les hommes des femmes et, parmi ces dernières, celles qui le portent de celles qui devraient le porter), et même si cet accessoire peut, aux yeux de certain(e)s, constituer une errance (passagère), il n’interdit pas le progrès.
Une société, dit-on, se juge à la place qu’elle accorde aux femmes. Encore faut-il que cette place ne soit pas seulement déterminée par les hommes, mais bien choisie et conquise par les femmes elles-mêmes. Un autre récent projet de loi, déposé lui aussi par un homme, est très éclairant à cet égard. Il s’agit bien sûr de cette sournoise proposition destinée à lutter contre l’insécurité routière, mais débouchant par la bande sur l’attribution au foetus d’un statut de personne. Ce projet n’a pu être enterré in extremis que grâce à la vigilance de quelques femmes, de droite comme de gauche, refusant la protection suspecte de ce parlement presque exclusivement masculin. Ne se voulant ni putes, ni soumises, les femmes sont bien inspirées de se méfier de ces protections viriles si généreusement offertes. Car il n’existe que deux types d’hommes qui protègent les femmes contre leur gré. Les intégristes de tous poils… et les maquereaux.
Restons donc vigilants face à ces ballons d’essais législatifs qui semblent faire partie d’une vaste offensive plus ou moins concertée en faveur du retour à un ordre moral, au nom d’une certaine idée de la nature (religieuse) des choses. Et revenons-en pour finir au débat sur la réglementation de la publicité, voire sa censure préalable. Certes, toutes les publicités ne sont pas du meilleur goût. Mais la publicité n’a pas, hélas, le monopole de la vulgarité. Peut-on vraiment légiférer contre le mauvais goût, qui est généralement « le goût des autres » ? En dehors des interdits catégoriques touchant au racisme et à la pédophilie, déjà justement et sévèrement sanctionnés par la loi, le remède que constitue la censure, ou plus grave encore l’autocensure, n’est-il pas pire que le mal ? La démocratie, dit-on, est le plus mauvais des systèmes à l’exception de tous les autres. N’en serait-il pas de même pour la liberté d’expression ?
Le degré zéro de la communication
par Jean-Pierre Martinez, sémiologue. Article paru dans CB News n°825, 7 mars 2005
 Roland Barthes, l’un des pères fondateurs de la sémiologie, qui a aussi initié en France les applications de cette discipline dans le domaine de la communication publicitaire, a écrit en son temps un essai dont le titre est resté gravé dans les mémoires par ses allures de slogan : Le Degré Zéro de l’Écriture. Être un intellectuel de haut vol ou un grand serviteur de l’état ne dispense pas d’avoir le sens de la formule qui fait vendre. On s’appuiera ici de façon très libre sur les idées brassées dans cet ouvrage pour mettre en perspective le récent épilogue de la dernière saga médiatico-politique en date, que l’on aurait pu intituler « Le Degré Zéro de la Communication ».
Roland Barthes, l’un des pères fondateurs de la sémiologie, qui a aussi initié en France les applications de cette discipline dans le domaine de la communication publicitaire, a écrit en son temps un essai dont le titre est resté gravé dans les mémoires par ses allures de slogan : Le Degré Zéro de l’Écriture. Être un intellectuel de haut vol ou un grand serviteur de l’état ne dispense pas d’avoir le sens de la formule qui fait vendre. On s’appuiera ici de façon très libre sur les idées brassées dans cet ouvrage pour mettre en perspective le récent épilogue de la dernière saga médiatico-politique en date, que l’on aurait pu intituler « Le Degré Zéro de la Communication ».
Le degré zéro de l’écriture, pour simplifier, c’est le mythe d’un langage transparent dans lequel, entre le signifiant et le signifié, il n’y aurait pas l’épaisseur d’une connotation. Un langage objectif, donc, derrière lequel le sujet parviendrait à s’effacer complètement. Cette idée d’une objectivité absolue, purement abstraite et théorique, est d’un grand intérêt pour mieux appréhender, par différence, la personnalité que tout un chacun donne à voir et à entendre en s’exprimant de multiples façons, et pas seulement verbales (une façon de parler mais aussi de bouger ou de s’habiller, par exemple). Cependant, nul n’a jamais postulé que la transparence était un idéal en soi, et notamment une garantie de popularité pour nos hommes politiques, en France en tout cas.
En effet, ce qui se niche, pour Barthes, dans la distance existant entre le discours bien réel d’un sujet spécifique, et ce que serait le degré zéro d’un langage objectif, c’est le style, comme expression d’une personnalité. Le style, c’est l’homme, disait Buffon. Et dire de quelqu’un qu’il est transparent n’est pas toujours un compliment. Il faut croire que dans le feuilleton médiatico-politique auquel on faisait allusion tout à l’heure, l’homme, en manquant de style, a paru manquer singulièrement de personnalité. Bizarrement, on pourrait donc dire que notre Ministre a péché par excès de transparence… et manque d’épaisseur.
Car bien d’autres avant lui, de gauche comme de droite, ont menti beaucoup plus. Mais aussi beaucoup mieux, oserait-on dire. Et avec plus de panache. Le mensonge n’est pas un péché en soi. Le Vatican lui-même ne nous annonce-t-il pas tous les jours que le pape n’a jamais été en aussi bonne forme ? Dans un autre registre, on se souvient encore de ce fabuleux Ministre de la Communication irakien annonçant à la télévision la déroute des américains, alors que leurs chars manoeuvraient déjà en arrière-plan. On ne pouvait finalement qu’admirer le panache de ce Matamore, conjurant la réalité par une foi à déplacer des armées.
Mais si l’on peut pardonner aux politiciens leurs petits ou gros mensonges, le manque de style, en France, est une faute impardonnable. Mentir par omission, pour protéger une princesse adultérine (également logée à l’époque, dit-on, aux frais de la République), peut faire d’un homme d’état un personnage de roman. Un personnage qui, en l’occurrence, s’était déjà dessiné lui-même tout au long de son histoire par ses nombreuses « zones d’ombre ».
Notre transparent Ministre, hélas pour lui, avant l’affaire qui vient de lui coûter son poste, était vierge de toute image, positive ou négative. Il correspondait parfaitement à ce que Lévi-Strauss a appelé un « signifiant flottant », c’est-à-dire une coquille provisoirement vide de toute charge sémantique, et donc disponible pour accueillir un trop plein de sens qui, tel un bernard-l’ermite, n’aurait lui-même pas encore réussi à trouver où se loger. Les coquilles, en effet, ont horreur du vide. Sans image, notre Ministre s’exposait inévitablement à cristalliser sur son nom, au moindre faux pas, toutes les frustrations qui n’avaient pas encore trouvé leur tête de turc. Lorsque ce fut fait, on entrait inéluctablement dans le processus sacrificiel du bouc émissaire.
D’abord trop transparent, puis soudain submergé par un flot d’images exclusivement négatives ne laissant place à aucune autre, cet infortuné mal-communiquant aura bien du mal à se refaire une virginité, même par un retour à un anonymat devenu impossible. Quand d’autres vieux routards de la politique ont survécu à des scandales beaucoup plus graves, selon le célèbre principe qu’un clou chasse l’autre, notre Ministre pourrait bien garder à vie cette simple épine dans le pied.
En France, paraît-il, on aime à se choisir des dirigeants patinés voire un peu cabossés par l’histoire, la vie, les blessures, et même par quelques turpitudes les rendant plus humains, donc plus proches de leur électorat. Il y a de grands mensonges et des opacités complexes qui fascinent. Le Promeneur du Champs de Mars en est une bonne illustration. Il y a aussi de trop petites vérités que la simple transparence ne saurait faire pardonner.
Temps de cœurs disponibles
par Jean-Pierre Martinez, sémiologue. Paru dans CB News n°818, janvier 2005.
 Face à l’absurdité de la catastrophe qui vient de toucher l’Asie, on ne peut que remarquer le sincère désarroi de beaucoup devant l’impossibilité de lui donner un sens, et les tentatives pathétiques de certains pour imposer malgré tout à ce chaos une interprétation compatible avec leur vision du monde. Pour les croyants de toute obédience, y compris sur place, il s’agirait bien sûr d’un juste châtiment divin aux péchés des hommes, dans une région d’ailleurs tristement réputée pour son tourisme sexuel. Cette conception religieuse, bien qu’évidemment récusable, a au moins le mérite de la cohérence. Certains écologistes, en revanche, pris à contre-pied par ce brutal raz-de-marée naturel (en lieu et place de la lente montée des eaux consécutive au réchauffement culturel de la planète) sont contraints à quelques contorsions pour intégrer ce cataclysme dans leurs prévisions. Ils n’ont d’autre choix que de présenter ce désormais célèbre tsunami (dont le nom évoque une cruelle divinité exotique) comme un avertissement dispensé par une nature en révolte contre les outrages que l’Homme lui fait subir. On le voit, il suffit de remplacer Dieu par La Nature, et le péché par les pollutions (diurnes et nocturnes), pour constater l’étroit cousinage entre cette conception naturaliste du monde et le schéma de pensée religieux.
Face à l’absurdité de la catastrophe qui vient de toucher l’Asie, on ne peut que remarquer le sincère désarroi de beaucoup devant l’impossibilité de lui donner un sens, et les tentatives pathétiques de certains pour imposer malgré tout à ce chaos une interprétation compatible avec leur vision du monde. Pour les croyants de toute obédience, y compris sur place, il s’agirait bien sûr d’un juste châtiment divin aux péchés des hommes, dans une région d’ailleurs tristement réputée pour son tourisme sexuel. Cette conception religieuse, bien qu’évidemment récusable, a au moins le mérite de la cohérence. Certains écologistes, en revanche, pris à contre-pied par ce brutal raz-de-marée naturel (en lieu et place de la lente montée des eaux consécutive au réchauffement culturel de la planète) sont contraints à quelques contorsions pour intégrer ce cataclysme dans leurs prévisions. Ils n’ont d’autre choix que de présenter ce désormais célèbre tsunami (dont le nom évoque une cruelle divinité exotique) comme un avertissement dispensé par une nature en révolte contre les outrages que l’Homme lui fait subir. On le voit, il suffit de remplacer Dieu par La Nature, et le péché par les pollutions (diurnes et nocturnes), pour constater l’étroit cousinage entre cette conception naturaliste du monde et le schéma de pensée religieux.
Et pourtant non, il faut s’y résoudre. L’absurde n’a par définition aucun sens. C’est à l’Homme de donner une signification au chaos en tentant de l’organiser. Mais si une catastrophe naturelle n’a pas de sens, parce qu’elle n’a pas de cause intentionnelle, elle peut fort bien avoir des conséquences significatives. À ce propos, c’est une autre réplique au séisme asiatique qui semble avoir eu lieu le lundi 3 janvier sur TF1, quand le téléspectateur éberlué s’est vu emporté sans transition d’un JT prolongé jusqu’à 21 heures 30, par solidarité avec les victimes d’Asie, à un tardif téléfilm policier. Mais quel raz de marée humanitaire avait donc balayé la plage publicitaire ? Et nous qui pensions que TF1 n’était là que pour vendre du temps de cerveau disponible ! Voilà qu’après avoir sollicité pendant plus d’une heure et demie la compassion et la générosité de tant de coeurs disponibles, la chaîne passait tout bonnement sans préavis la pub par pertes et profits… Etre ainsi transporté, sans transition par le sas publicitaire, d’une lointaine réalité à une fiction de proximité, avait d’ailleurs quelque chose d’un peu perturbant. Et il faut reconnaître que le soudain sevrage de cette pub rassurante, signe s’il en fallait que quelque chose de grave s’était vraiment passé, achevait de nous inquiéter. Une télé sans publicité, c’est comme une plage sans touriste. Une image de ce que serait un monde sans frivolité…
Ogilvy, Seguéla, Feldam, Michel. Leurs campagnes ressemblent-elles à leurs idéologies.
Article de Jean-Marie Floch, directeur, et Jean-Pierre Martinez, chargé d’études, Unité « Études Sémiotiques » d’Ipsos. Paru dans Stratégies n°477, juin 1985.
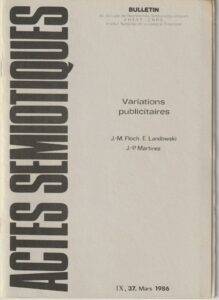 Système de croyance et crédibilité publicitaire.
Système de croyance et crédibilité publicitaire.
Analyse sémiotique du discours des médecins sur le vieillissement du cerveau.
Article paru dans Actes sémiotiques, IX,37. Mars 1986. Direction du numéro intitulé Variations publicitaires par Jean-Pierre Martinez.
Exemplaire en vente sur le site du Comptoir des Presses d’Université
Être, paraître, transparaître
par Jean-Pierre Martinez, sémiologue. Article paru dans Contrôle, la revue de l’Autorité de sureté nucléaire, n°141 juillet 2001. Avant-propos du dossier intitulé « Sureté nucléaire et transparence » (Lien vers le dossier complet)
 L’étymologie de la transparence
L’étymologie de la transparence
L’origine du mot « transparence » est… transparente. Attesté depuis le Moyen-Age, « transparence » vient du latin « trans » (par delà ou à travers) et « parere » (paraître). La limpidité de cette source explique que le sens du mot ne varie guère au cours du temps et qu’il reste aujourd’hui à peu près univoque. L’analyse strictement linguistique du mot «transparence», d’ailleurs, tourne court dans la mesure où elle renvoie immédiatement à ce qu’on appelle des universaux (« à travers » et « paraître »), c’est-à-dire des éléments de sens premiers, non décomposables en éléments plus simples qui les constitueraient par combinaison. « Être » est un autre de ces quelques universaux seulement définissables par relation avec leur négation (être… ou ne pas être) ou en rapport avec l’affirmation de leur contraire (être… ou paraître). Transparaître, c’est paraître à travers. Un point, c’est tout. Le mot « transparence », en tant que signe, est lui-même transparent : il laisse clairement voir son signifié derrière (à travers) son signifiant. Point ici d’étymologie mystérieuse, de métaphore obscure ou de propos équivoque. Au renfort de la linguistique (étude des mots et des phrases), il faudra donc appeler la sémiotique (étude des signes et des idéologies) pour nous éclairer sur le sens caché de la transparence.
La signification de la transparence
La transparence et le visuel. La transparence s’entend au sens propre ou figuré. Au sens propre, la transparence relève du visuel : c’est la translucidité (qualité d’un corps qui laisse passer la lumière et qui laisse donc paraître les objets qui se trouvent derrière lui). Au figuré, la transparence symbolise la vérité : c’est l’évidence et la clarté (qualité de ce qui laisse paraître la réalité tout entière, qui exprime la vérité sans l’altérer, qui laisse voir le sens). Le contraire de la transparence, c’est l’opacité et l’obscurité. La transparence, tout comme l’opacité, est une qualité graduelle : un objet peut être plus ou moins transparent, depuis le diaphane qui dévoile troublement jusqu’au limpide qui laisse voir avec netteté. Ainsi, entre le vaporeux (un peu transparent) et le brumeux (un peu opaque), c’est la façon de considérer les choses qui change (comme dans le cas du verre à moitié plein ou vide). La transparence est surtout associée à l’eau (clair comme de l’eau de roche). L’eau d’un diamant ou d’une perle désigne ainsi sa transparence. Contrairement à l’air, en effet, trop immatériel pour être vraiment imaginé comme un obstacle, la figure de l’eau, surtout sous sa forme solide (glace, verre, cristal), représente bien le paradoxe de la transparence renvoyant à l’idée d’un obstacle réel mais invisible, laissant passer la lumière mais rien d’autre, et séparant sans cacher.
La transparence et l’obstacle. Il faut distinguer le substantif « transparence » (situation où une chose apparaît à quelqu’un à travers une autre) du verbe « transparaître » (paraître au travers de quelque chose) et de l’adjectif « transparent » (qui laisse transparaître). La structure actantielle de la transparence, de fait, suppose au moins trois rôles distincts : un objet vu, un sujet voyant, et entre eux un obstacle nié en tant qu’opposant visuel. Or ces trois rôles sont passifs : l’objet transparaît sans s’exhiber, l’obstacle se contente de laisser transparaître, le sujet voit sans regarder. La transparence, c’est un objet qui apparaît sans rien faire pour cela, à un sujet qui n’a rien demandé, à travers un obstacle qui ne joue pas son rôle. La transparence ne décrit pas une action mais un état. En l’occurrence un état de presque parfaite communication entre le spectateur et le phénomène qui lui apparaît malgré l’obstacle inévitablement niché dans la distance qui les sépare. Même s’il est réduit à un presque rien (si transparent qu’il donne l’impression de ne pas exister), c’est toutefois l’obstacle qui donne tout son sens à la transparence dans la mesure où il manifeste en le niant le divorce entre l’être (de l’objet) et le paraître (à un sujet).
Cependant, à partir du moment où la transparence n’est plus considérée comme un état mais comme un acte de communication, il faut prendre en compte un quatrième intervenant, non plus passif mais actif, dont le rôle est de lever l’obstacle au savoir de l’observateur. En réalité, un même acteur joue souvent le rôle de sujet dévoileur et d’objet dévoilé dans le cadre d’une action réflexive (se dévoiler, se découvrir, se mettre à nu).
La transparence et la vérité. La transparence, en tant que figure de la vérité (être et paraître : le nu), s’oppose d’abord au secret (être et ne pas paraître : le voilé). Est affiché comme transparent ce qui pourrait être caché mais ne l’est. Là encore, la transparence suppose un obstacle neutralisé en tant qu’écran visuel ou plus généralement en tant qu’opposant au savoir vrai d’un observateur. La transparence convoque donc un récit de la véridiction. Ainsi, en devenant transparent, le voile fait passer l’observateur du secret au vrai. La transparence, cependant, peut aussi s’opposer à l’illusion (ne pas être et paraître: le déguisé), qui non seulement cache la vérité mais la travestit. Pour passer de l’illusoire au vrai, on devra dénoncer le mensonge comme faux (ne pas être et ne pas paraître), c’est-à-dire faire reconnaître le déguisement comme tel, avant de le faire tomber pour révéler la véritable nature des choses. Le manque de transparence, quant à lui, supposera le masquage (secret) et éventuellement le maquillage (illusion) de la vérité. La transparence apparaît finalement comme une absence à la fois de secret et de mensonge.
Les implications de la transparence
La transparence et la confiance. Au sens propre, la transparence n’autorise qu’un contact visuel. On peut voir mais pas toucher, sentir, goûter, entendre. Or, en ne révélant qu’un aspect de la vérité, la transparence peut paraître illusoire. Elle n’exclut pas le mensonge par omission : ce que l’on montre est vrai, mais n’est pas forcément toute la vérité. Le doute s’installe. On ne nous montre que ce qu’on veut bien nous montrer. Comme l’illusionniste qui nous demande de regarder ici afin que nous ne voyions pas ce qui se passe là. Pour être crédible, la transparence doit être totale. Pour être effective, elle suppose en outre la capacité de l’observateur à décoder ce qu’on lui donne à voir, dont la complexité peut constituer un camouflage en soi. L’obstacle peut aussi être situé du côté du sujet, dans son manque de discernement ou son aveuglement. Finalement la transparence, même si elle relève du savoir et non du croire, ne va pas sans confiance. Confiance de l’observateur, qui veut bien croire que ce qu’on lui montre est la vérité. Confiance de celui qui, se mettant à nu, veut croire que sa franchise ne sera pas exploitée comme une faiblesse.
La transparence et le pouvoir. Le manque de transparence (le secret ou le mensonge: la rétention ou la déformation de l’information), est une des bases du pouvoir, surtout lorsqu’il se veut absolu. Si la démocratie promeut officiellement la transparence, la dictature ne peut s’accorder d’une libre circulation du savoir. Car partager le savoir, c’est partager le pouvoir, et donc perdre un peu du sien. Dans tous les jeux stratégiques et manipulatoires, au poker comme en affaires, ou à la guerre, le gagnant est celui qui parvient non seulement à ne pas révéler la véritable nature des cartes qu’il a en main, mais encore à faire croire qu’il possède des cartes qu’il n’a pas en réalité. On cache ses faiblesses et on donne l’illusion de sa force pour dissuader. Ou, à l’inverse, on fait croire à sa faiblesse afin de surprendre par sa force. Au contraire, on l’a vu, se découvrir c’est se mettre en danger, lorsque l’on considère le partenaire comme un adversaire.
La transparence et la responsabilité. Mais veut-on tout savoir ? Car, si savoir constitue un pouvoir et peut être un droit, c’est aussi une responsabilité. Certains préfèrent ainsi ne pas savoir, pour pouvoir dire un jour pour se disculper qu’ils ne savaient pas. En effet, la différence entre la responsabilité et la culpabilité, c’est bien le savoir. Les responsables politiques savaient-ils pour la torture en Algérie ? Les électeurs d’Hitler savaient-ils pour les camps de la mort ? Toute vérité n’est pas bonne à savoir et à dire, même après coup. La transparence, lorsqu’elle appelle la repentance, n’a pas que des partisans.
Les limites de la transparence
La transparence et le mystère. La transparence n’est pas une qualité universellement valorisée. Si un raisonnement brumeux ne saurait être satisfaisant pour l’esprit, un voile vaporeux et un maquillage subtil subliment la beauté. La transparence ne vaut que dans l’univers du savoir et du besoin, pas dans celui du croire et du désir. Aucune transparence, mais au contraire beaucoup de mystère (mystère, mythique et mystique ont la même étymologie) dans tout ce qui touche à la religion et la foi. Les fantômes eux-mêmes n’apparaissent que voilés. L’apparition miraculeuse est l’exception qui confirme cette règle du mystère constitutive du sacré. Ainsi, dans la Bible, point de démonstration philosophique de l’existence de Dieu, mais un discours parabolique et allégorique dont il revient à des spécialistes de dévoiler les sens possibles. Dans tous les domaines, et notamment dans ce qui touche au pouvoir politique, la culture du secret participe à la sacralisation. N’est pas qui veut dans le secret des dieux. Décrivant non plus un objet mais un sujet, enfin, la transparence n’est pas forcément une qualité. Dire de quelqu’un qu’il est transparent, cela veut dire qu’il est si franc qu’on peut lire ses pensées à travers ces fenêtres de l’âme que sont les yeux des gens purs. Ou bien qu’il a si peu de personnalité qu’il est insignifiant. La profondeur rend difficile le transparaître de la lumière. A l’inverse, le manque de clarté n’est pas une garantie de profondeur.
La transparence et l’intimité. La transparence, souvent revendiquée dans la sphère publique, est strictement encadrée dans la sphère du privé, protégée par le droit à l’intimité, le respect de la dignité, le secret professionnel. La transparence, en effet, suppose l’existence d’un contrat : le regardé, en s’offrant au regard, se soumet au jugement du regardant pour lui prouver qu’il mérite bien sa confiance. A l’inverse, vous n’avez pas le droit de voir ce qui ne vous regarde pas et ne veut pas être regardé. D’où l’ambiguïté de la presse à scandale. Où commence et finit la vie privée des gens publics? Le débat autour des « reality shows», émissions dont les noms suffisent à décrire le principe (Big brother, Bas les masques, Strip-tease, Confessions intimes…), témoigne aussi de cette ambiguïté. Les chaînes concernées se défendent en soulignant le consentement des cobayes: le voyeurisme des spectateurs est autorisé par l’exhibitionnisme des « acteurs », les uns et les autres étant liés de fait par un contrat librement consenti. Enfin, le débat législatif autour du droit à l’image se perd dans la contradiction entre le devoir de montrer la vérité et la nécessité de respecter la dignité des personnes privées, réelles… et identifiables. On peut ainsi montrer une tribu d’Africains faméliques mais pas un homme politique français avec les menottes que lui a passées la justice de son pays.
La transparence et l’objectivité. Le problème de la transparence (sa possibilité ou son impossibilité) implique un débat entre différentes théories de la connaissance. Dans la mesure où c’est lui qui pose les questions (y compris celle de sa propre réalité), le sujet n’est jamais remis en cause dans son existence (je pense donc je suis). L’objectivité du monde, en revanche, peut être mise en doute. Pour les objectivistes, le monde a une réalité autonome par rapport au sujet qui l’observe (la transparence de l’obstacle est alors envisagée comme un idéal à atteindre pour accéder à une connaissance « immédiate »). Pour les subjectivistes, au contraire, il n’y a d’autre réalité que celle du sujet qui se fait des idées pour imaginer le monde (obstacle et transparence ne sont dans ce cas que des idées parmi d’autres). Pour les structuralistes, enfin, sujet et objet n’existent que dans leur relation et il n’y a d’autre réalité appréhendable que celle de l’obstacle, à savoir la langue qui sert au sujet à penser le monde et à se penser lui-même (la transparence n’est alors qu’un effet de sens). Le concept de transparence convoque donc d’abord une philosophie objective : ce qui transparaît malgré l’obstacle doit être doté au départ d’une réalité objectivable.
La possibilité d’une transparence nucléaire
Le nucléaire a d’abord été associé à la chose militaire. Il s’inscrivait d’entrée dans le cadre du
secret défense, à l’opposé de la transparence. Le nucléaire civil, pour d’évidentes raisons de
sécurité, impose aussi parfois certaines restrictions à la transparence. En outre, l’énergie représentant un enjeu stratégique lié à l’indépendance nationale, la limite entre le nucléaire militaire et civil est floue. Le nucléaire en général participe donc plus ou moins de la raison d’État, et une partie du public peut avoir l’impression qu’on ne lui dit pas tout, notamment parce qu’il ne serait pas en mesure de tout comprendre. Pour le profane, en effet, le nucléaire, invisible et largement incompréhensible, se situe à la frontière de la matière et de l’immatériel, aux portes du surnaturel. Il renvoie, du côté du passé, au mystère de l’origine du monde. Du côté de l’avenir, il porte en lui la promesse d’un monde meilleur… ou la menace d’une apocalypse. Mais le public dans son ensemble souhaite-t-il être pleinement informé ? Bénéficiant des avantages du nucléaire, il ne veut pas forcément assumer la responsabilité associée à la connaissance des risques de cette énergie un peu « magique ». Finalement, la transparence nucléaire suppose la clarification du contrat social par lequel les citoyens acceptent de prendre en charge collectivement la maîtrise des coûts réels ou virtuels d’un choix énergétique répondant à un besoin de la société. La demande de transparence faite aux responsables du nucléaire ne peut dès lors aller, du côté du public, sans une volonté de partage des responsabilités. Pour en revenir à la linguistique, la transparence, sur le mode réflexif, c’est la conscience (en l’occurrence collective), donc le contraire du refoulement.
ARTICLES INÉDITS
De l’arbitraire du signe au symbole de l’arbitraire
par Jean-Pierre Martinez, sémiologue, mars 2004
À quelques jours du vote d’une loi interdisant les signes religieux à l’école, il peut être intéressant de rappeler ce qu’est un signe. Le signe peut être comparé très simplement à une pièce de monnaie. Côté face, un signifiant (cf. le son d’un mot). Côté pile, un signifié (cf. le sens de ce même mot). Comme la pièce de monnaie, le signe entre par ailleurs dans un système d’échange généralisé. Echanger des mots avec quelqu’un, c’est quelque part lui rendre la monnaie de sa pièce… C’est Saussure, père du structuralisme, qui le premier a souligné l’une des caractéristiques fondamentales du signe linguistique, à savoir son aspect « arbitraire ». Il mettait ainsi en évidence le fait qu’il n’existe, a priori, aucun lien nécessaire entre la dimension sonore d’un mot et le sens auquel il renvoie. C’est pourquoi, lorsqu’on passe d’une langue à l’autre, le même son peut renvoyer à des significations distinctes, tandis que le même sens est véhiculé par des sons différents. Tous les signes, cependant, ne sont pas arbitraires. Il existe, par exemple, un lien naturel entre l’image de la balance et l’idée de la justice à laquelle elle renvoie : dans les deux cas, il s’agit de peser le poids et le contrepoids, le pour et le contre. Plutôt que de signe, arbitraire, il faut alors parler de symbole, motivé.
Comment, cependant, fonder en droit l’interdiction à l’école de certains signes plutôt que d’autres ? Tout d’abord, il convient de noter que tous les signes visés par la loi ne sont pas arbitraires, au sens de Saussure, mais qu’ils constituent parfois des symboles, ostentatoires par l’évidence même (pour ne pas dire la brutalité) de leur signification. Le voile, notamment, n’est pas un signe arbitraire qui nécessiterait, pour être décodé, la connaissance d’un code préalable, mais un symbole universel immédiatement lisible. Il existe, en effet, un lien si l’on peut dire naturel entre l’obligation, pour la femme, de se voiler la face, et l’idée de soumission que cette obligation sous-tend. Au-delà du lien, arbitraire ou motivé, unissant le signifiant au signifié, il faut ensuite s’interroger sur le contenu du signe ou du symbole à interdire. De ce point de vue, pourquoi ne pas reconnaître franchement que la loi en discussion ne cible pas principalement les signes identitaires, mais bien les signes ou symboles idéologiques, lorsque les idéologies en question sont incompatibles avec les valeurs laïques de la République ? Le voile n’apparaît pas comme un simple signe d’appartenance communautaire, mais comme un symbole d’obéissance absolue de la femme à une autorité masculine et/ou religieuse se situant elle-même au-dessus de (et donc hors) la loi républicaine. Des mots au voile qui pourrait les recouvrir, on passe ainsi de l’arbitraire du signe, gage d’une liberté de penser et d’évoluer, au symbole de l’arbitraire, qui en est la négation.
Sémiologie de la burqa : signe, symbole, indice ou signal ?
par Jean-Pierre Martinez, sémiologue. Octobre 2010.
Avec la discussion sur l’opportunité d’interdire en France le port de la burqa s’ouvre à nouveau un débat sur l’encadrement législatif du port de signes religieux dans la sphère publique et laïque. Il peut dès lors être intéressant de rappeler ce qu’est un signe, et ce qui le distingue tout d’abord du symbole. D’un point de vue sémiologique, le signe peut être comparé à une pièce de monnaie. Côté face, un signifiant (le son d’un mot, par exemple). Côté pile, un signifié (le sens de ce même mot). Comme la pièce de monnaie, le signe entre par ailleurs dans un système d’échange généralisé. Echanger des mots avec quelqu’un, c’est en quelque sorte lui rendre la monnaie de sa pièce…
C’est Saussure, père du structuralisme, qui le premier a souligné l’une des caractéristiques fondamentales du signe linguistique, à savoir son aspect « arbitraire ». Il mettait ainsi en évidence le fait qu’il n’existe, a priori, aucun lien nécessaire entre la dimension sonore d’un mot, et le sens auquel il renvoie. C’est pourquoi, lorsqu’on passe d’une langue à l’autre, le même son peut renvoyer à des significations distinctes, tandis que le même sens est véhiculé par des sons différents.
Tous les signes, cependant, ne sont pas arbitraires. Il existe ainsi un lien naturel entre l’image de la balance et l’idée de la justice à laquelle elle renvoie : dans les deux cas, il s’agit de peser le poids et le contrepoids, le pour et le contre. Plutôt que de signe, arbitraire, il faut alors parler de symbole, motivé. Comment, cependant, fonder en droit l’interdiction de certains signes (religieux, par exemple) plutôt que d’autres ?
Tout d’abord, il convient de noter que tous les signes éventuellement concernés ne sont pas arbitraires, au sens de Saussure, mais qu’ils constituent parfois des symboles, par l’évidence (pour ne pas dire la brutalité) de leur signification. Ainsi, le voile et a fortiori la burqa, ne sont pas des signes arbitraires qui nécessiteraient, pour être décodés, la connaissance d’un code préalable : ils constituent des symboles universels immédiatement lisibles. Il existe, en effet, un lien si l’on peut dire naturel entre l’obligation, pour la femme, de se voiler la face voire d’emprisonner tout son corps dans une prison grillagée, et l’idée d’aliénation que cette obligation sous-tend.
Au-delà du lien, arbitraire ou motivé, unissant le signifiant au signifié, il faut ensuite s’interroger sur le contenu du signe ou du symbole à interdire. De ce point de vue, pourquoi ne pas reconnaître franchement que l’interdiction de la burqa ne la vise pas en tant que signe identitaire, mais bien en tant que symbole idéologique, dans la mesure où l’idéologie qu’elle véhicule est incompatible avec les valeurs laïques de la République (notamment l’égalité des sexes) ? La burqa n’apparaît pas comme un simple signe d’appartenance communautaire, mais comme un symbole de soumission absolue de la femme à une autorité masculine et/ou religieuse se situant elle-même au-dessus de (et donc hors) la loi républicaine. Des mots au voile qui pourrait les recouvrir, on passe ainsi de l’arbitraire du signe, gage d’une liberté de penser et d’évoluer, au symbole de l’arbitraire, qui en est la négation éternel.
Mais le port de la burqa va bien au-delà du symbole : en limitant matériellement et non pas seulement symboliquement la liberté de la femme (en l’empêchant de pratiquer bon nombre d’activités physiques), la burqa passe du statut sémiologique de signe à celui d’indice : comme le boulet pour les prisonniers ou la laisse pour les chiens, la burqa ne se contente pas de symboliser une entrave à la liberté, elle indique la réalité de cette aliénation et contribue à la mettre en oeuvre. Lorsqu’en outre cet indice, en s’affichant de façon ostentatoire, devient prosélytisme et provocation, il acquiert le statut sémiologique de signal.
Quant au prétendu consentement des femmes qui adopteraient volontairement cet instrument d’auto-flagellation, il ne légitime en rien sa pratique. Sauf à penser qu’à l’inverse, la sincérité des nudistes (qui eux n’attentent en rien à l’égalité des sexes et à la dignité de la femme) légitimerait l’exhibitionnisme. Ou que le bon vouloir des faibles d’esprit embrigadés par toutes sortes de sectes exonère automatiquement ces dernières, et les autorise à prospérer en toute légalité. Décidément, pour tous les amoureux de la liberté, ce signal sémiologique qu’est la burqa doit être perçue comme un signal d’alarme…
Un vrai calvaire
par Jean-Pierre Martinez, sémiologue. Mars 2005
Des spectateurs du monde entier regardant à la télévision une foule vaticane, regardant elle-même sur un écran géant un vieil homme presque mourant, de dos, seul dans son salon… en train de les regarder à la télévision. Tel était le programme du 20 heures sur toutes les chaînes, en ce Vendredi Saint. C’est ce qu’on appelle, dans le jargon de la rhétorique, une mise en abyme. Un abîme dans lequel on pourrait en effet se demander, face à un tel vide, si l’on n’est pas tout près de tomber.
Un pape de l’audiovisuel autrefois capable de bénir l’humanité en version originale, dans des dizaines de langues, depuis le balcon de sa Tour de Babel. Mais désormais muet. C’est aussi tout un symbole. Lorsqu’on ne peut vraiment plus se comprendre, et qu’on n’a peut-être plus rien à se dire, il ne reste plus qu’à se taire. Et à se regarder vivre et mourir à la télévision…
L’été de la canicule, on a redécouvert nos vieux, longtemps escamotés au profit des seniors. Aujourd’hui, l’agonie somme toute ordinaire – quoique surmédicalisée et surmédiatisée – d’un homme, incarnant la funeste destinée de chacun, est assimilée à un chemin de croix. Mégalomanie d’un seul, ou perte du sens commun ? Ce noble vieillard, en effet, se prend pour le Christ. Il n’y a pas si longtemps, l’Église brûlait pour moins que cela les plus illuminées de ses ouailles. Mais il est vrai qu’il y a des moments comme ce Vendredi Saint où rester devant sa télé tient du calvaire. Et en apprenant que le Prince Rainier n’allait pas bien non plus, le téléspectateur se disait qu’il n’avait pas fini de porter sa croix…
À l’heure où la cohérence de la vaste Europe est menacée par les effets contraires de mouvements centrifuges (une expansion diluant son identité) et centripètes (les tentations de replis nationalistes), l’actuelle fascination pour les tragi-comédies qui se nouent dans des pays en miniature ne semblent pas tout à fait fortuite. Le Vatican ou Monaco, c’est la nostalgie pour ces petits états mythiques d’autrefois dont, à l’occasion d’un mariage, d’un enterrement… ou d’un référendum, on pouvait rassembler tous les sujets en un même lieu, pas plus grand que la Place Saint-Pierre. Hélas, ces états confettis n’ont survécu que dans leurs versions autocratiques ou théocratiques. Existe-t-il encore quelque part dans le monde une République à échelle humaine, comme celle de Platon et de l’antique Athènes ?
Oui décidément, le raz-de-marée du non que nous prédisent les sondeurs semble bien motivé par des peurs très profondes et très archaïques, qu’il convient de comprendre si l’on veut les combattre. Faute de quoi, nous risquerions de succomber à la fascination de ce que René Girard appelait le désir mimétique, dans une version ici régressive : l’humanité toute entière regardant à la télévision une foule plus petite, regardant à la télévision un homme mourant seul… face à l’humanité toute entière.
N’oubliez pas les paroles, un vrai conte de fées
Analyse sémiologique d’un succès médiatique, par Jean-Pierre Martinez, scénariste, dramaturge et sémiologue. Janvier 2020.
 À l’antenne depuis plus de douze ans, le jeu télévisé « N’oubliez pas les paroles » permet encore aujourd’hui à France 2 de dépasser régulièrement sa concurrente TF1 en termes d’audience sur cette case de l’access prime time. Quelles sont les raisons d’un tel succès populaire, aussi large et aussi pérenne ?
À l’antenne depuis plus de douze ans, le jeu télévisé « N’oubliez pas les paroles » permet encore aujourd’hui à France 2 de dépasser régulièrement sa concurrente TF1 en termes d’audience sur cette case de l’access prime time. Quelles sont les raisons d’un tel succès populaire, aussi large et aussi pérenne ?
L’explication est en fait assez simple : N’oubliez pas les paroles est un vrai conte de fées. Cette émission en effet, rendez-vous quotidien avec le public, n’est pas un simple jeu, comme peut l’être Des Chiffres et des Lettres, mettant aux prises deux candidats plus ou moins insignifiants, rivalisant entre eux sur la base de leurs capacités cérébrales, les téléspectateurs étant indirectement invités à se mesurer également à ces deux compétiteurs.
Pour reprendre un concept à la mode, NPLP est un storytelling. Le storytelling est un mode de communication consistant à mettre en œuvre de façon sous-jacente à travers ce que l’on raconte, pour susciter l’empathie de son auditoire, un récit dont la structure est basée sur un schéma narratif similaire à celui des contes populaires. Cette structure commune à tous les contes, et au-delà à tous les discours comportant une dimension narrative (romans, films, pièces de théâtre), a été formalisée par le sémiologue Algirdas Julien Greimas. Le schéma narratif comporte quatre épisodes qui s’enchaînent pour constituer un récit.
Contrat : présentation et caractérisation du héros par la définition de ses valeurs et de sa mission. Quel défi s’apprête-t-il à relever et dans quel but ? Dans un conte de fées, par exemple, un chevalier (digne de porter ce nom pour son courage physique et sa noblesse d’âme) se voit confier la mission de délivrer une princesse enlevée à ses parents par un être maléfique (ou un animal fantastique comme un dragon) qui la retient dans son château (ou dans son antre).
Compétence : épreuve qualifiante, sorte d’examen de passage auquel le héros est soumis afin de prouver sa capacité et sa légitimité à concourir pour l’épreuve principale. Dans un conte populaire, ce chevalier est confronté en chemin à plusieurs épreuves (trois, en général), consistant par exemple à résoudre des énigmes ou à combattre les alliés de son adversaire qui protègent son refuge.
Performance : épreuve principale, à savoir la grande confrontation pour laquelle le héros s’est préparé. Dans les contes populaires, il s’agit du combat épique contre un adversaire malfaisant, dangereux et parfois même doté de super-pouvoirs.
Sanction : épreuve glorifiante à travers laquelle le héros, s’il est sorti vainqueur de l’épreuve principale, se verra reconnu, honoré et récompensé. Dans les contes populaires, par exemple, il s’agira de la reconnaissance officielle par le roi de la prouesse du chevalier, qui reçoit en récompense de sa bravoure la main de la princesse ainsi que la bonne fortune qui va avec. Le héros peut aussi recevoir un insigne matériel, une marque distinctive comme une médaille, qui lui permettra d’afficher aux yeux de tous son statut d’être exceptionnel reconnu comme tel. A minima, il se contentera de la gloire que lui vaudra sa prouesse.
Dans NPLP, ce schéma narratif s’applique triplement :
EN AMONT DU JEU
Contrat : présélection des candidats principalement sur la base de leur « profil ». Tout candidat admis à passer les épreuves de sélection doit se montrer digne de concourir. Il s’agit en quelque sorte d’un examen de moralité. Les candidats potentiels doivent faire montre de valeurs positives et consensuelles. De fait, on a rarement vu un candidat très antipathique, même doté d’une mémoire exceptionnelle, accéder au statut de candidat officiel. En revanche, les candidats potentiels sont soigneusement sélectionnés pour n’exclure aucune catégorie sociale, en veillant à ce que les classes populaires et aussi les « minorités » soient très bien représentées.
Compétence : les différentes épreuves de sélection constitutives du casting à proprement parler, destinées à choisir parmi tous les candidats dignes de l’être ceux qui sont le plus à même par leurs capacités (en l’occurrence mémorielles) à jouer le rôle de challenger pour conquérir le titre de Maestro (symbolisé par le « micro d’argent »).
Performance : la succès du candidat à la dernière épreuve de sélection.
Sanction : la qualification du candidat comme challenger officiellement reconnu pour participer au jeu.
PENDANT LE JEU
Contrat : l’entretien préliminaire du candidat avec l’animateur, pendant lequel ce dernier interroge le challenger sur son identité, ses valeurs, ses projets, tout en lui rappelant sa mission et éventuellement les règles du jeu. Avant cela, au début de chaque émission, l’animateur rappelle l’identité, les valeurs et les projets du champion en titre.
Compétence : la première partie du jeu, consistant en une première épreuve destinée à déterminer qui des deux candidats concourra en premier pour l’épreuve principale : « la même chanson ».
Performance : l’épreuve principale consistant pour chacun des candidats à compléter les paroles de « la même chanson ». À moins que la victoire de l’un ou l’autre ne soit obtenu par KO, en se rendant d’entrée « irrattrapable ».
Sanction : confirmation par l’animateur du champion en titre dans son statut de héros ou destitution du champion et passation de pouvoir au challenger victorieux avec l’octroi du « micro d’argent ». La dernière partie du jeu relève aussi de la sanction par l’octroi au vainqueur d’une somme d’argent proportionnelle aux capacités mémorielles dont il fera montre lors de cette dernière épreuve glorifiante.
APRÈS LE JEU
Contrat : dans le meilleur des cas, à sa sortie du jeu, le champion destitué après un parcours particulièrement long et brillant sera néanmoins reconnu comme digne d’être membre, au moins provisoirement, des masters, le panthéon des plus grands ex-champions.
Compétence : lors de chaque cession ultérieure du jeu, l’appartenance des ex-champions au club très fermé des masters est potentiellement remise en cause par l’accession possible d’autres candidats à ce club, l’entrée de l’un provoquant automatiquement la sortie d’un autre, le moins bien placé.
Performance : occasionnellement, organisation de confrontations exceptionnelles lors d’émissions spéciales entre membres des masters.
Sanction : les vainqueurs de ces confrontations titanesques se voient confirmés dans leur statut de champion parmi les champions, et en cela pratiquement divinisés.
Le jeu NPLP est donc exactement et triplement structuré comme un conte de fées. Sauf qu’il s’agit bien en l’occurrence d’un « vrai » conte de fées, et pas du simple récit d’une histoire imaginaire, symbolique et édifiante. NPLP n’est pas une fiction. C’est, si ce n’est une réalité, du moins une télé-réalité, c’est à dire une réalité scénarisée. Mais les destins des participants sont bien réels. C’est une histoire vraie qui se déroule en direct sous nos yeux, dont on ne connaît donc pas la fin. Certes, les émissions sont enregistrées, mais elles sont diffusées sur le mode du direct, et les spectateurs ignorent par conséquent au début de chaque diffusion quelle sera l’issue de la confrontation.
C’est ainsi que nous en arrivons à ce qui fait le succès de ce jeu auprès du public, au-delà de ce mode de narration extrêmement efficace, du phénomène d’identification très fort lié à la réalité de ces personnages non fictionnels, et du suspense découlant de l’effet de direct.
Tout est mis en œuvre dans ce jeu pour faire émerger des champions, et plus encore peut-être des championnes, avec lesquelles le public puisse développer émission après émission une empathie maximale et toujours plus forte à mesure que l’enjeu, notamment financier mais surtout symbolique, augmente. Ces champions, en effet, sont toujours des héros ordinaires, dotés de capacités extraordinaires, et surtout des gens qui ont fait pour en arriver là un parcours extraordinaire, lui-même structuré d’ailleurs comme un schéma narratif :
Contrat : décision de concourir pour le casting.
Compétence : préparation intense au prix de sacrifices personnels importants.
Performance : réussite au casting après souvent plusieurs échecs.
Sanction : même en cas de défaite, la participation au jeu étant en soi un aboutissement, une reconnaissance, et un quart d’heure de célébrité.
Penchons-nous plus particulièrement un instant sur le cas de Margaux. Margaux est, il faut bien le dire, l’archétype même de la chic fille cependant parfaitement ordinaire : naturellement belle sans être outrageusement provocante et sexy, dotée de capacités mémorielles hors norme sans apparaître pour autant comme une surdouée, ouverte sur le monde sans être particulièrement cultivée, non dépourvue d’humour sans être cassante, généreuse tout en restant réaliste, battante sans être agressive, joueuse sans être tricheuse… Bref, Margaux, c’est « juste quelqu’un de bien », comme dit la chanson. Margaux, c’est quelqu’un comme nous. Ou comme on aimerait être. Quelqu’un qu’on aimerait avoir pour copine, ou pour femme, ou pour fille, ou pour belle-fille… Et c’est donc la fille qu’on voudrait voir gagner, pour lui permettre de réaliser ses rêves. Et nous de réaliser les nôtres par procuration. Margaux, c’est « Juste quelqu’un de bien, sans grand destin », à qui NPLP offre la possibilité de se forger malgré tout un destin exceptionnel.
Margaux, c’est une Cendrillon des temps modernes, dont NPLP, sous les yeux du public et avec son concours, va faire une reine : la reine Margaux. Certes, cette charmante jeune femme est loin d’être aussi miséreuse au départ que Cendrillon. Mais la vie n’a pas su reconnaître en elle un talent qu’elle cachait. Margaux fait partie, comme beaucoup d’entre nous, et plus particulièrement les femmes sans doute, de ces gens dont le système scolaire et la société en général n’ont pas su reconnaître à la fois les capacités intellectuelles et la grandeur d’âme. Et NPLP est là pour réparer cette injustice. Car NPLP, c’est l’anti-loto. Les gagnants ne le sont pas hasard. L’animateur ne manque pas une occasion de rappeler qu’ils doivent leur succès à leur travail acharné : « le travail paie ». Certes, il ne s’agit pas d’un discours révolutionnaire. Le contraire serait très étonnant sur une chaîne de télévision. Mais il s’agit néanmoins d’un discours acceptable par tous : la célébration de la réussite au mérite. Et qui plus est un mérite que personne n’avait décelé jusque-là, dans la mesure où il n’entrait pas dans les critères de l’éducation nationale ou du dressage professionnel.
Nous avons tous en nous un talent méconnu, y compris de nous-mêmes parfois. Voilà le message de NPLP. C’est ce talent-là qu’il faut découvrir et cultiver avec courage, obstination voire même abnégation. Et alors nos mérites seront un jour reconnus, et nous pourrons réaliser nos rêves. Un discours très « service public », donc. La réussite de Margaux, c’est potentiellement la nôtre. Et au-delà, la réussite de « N’oubliez pas les paroles », c’est encore la nôtre puisque c’est nous qui en regardant cette émission en faisons le succès, et contribuons à la célébrité des vainqueurs. Finalement c’est nous, téléspectateurs, qui sommes les maîtres du jeu. Comme dans un jeu vidéo, c’est nous-mêmes qui choisissons notre « champion par procuration », qui l’accompagnons dans ses épreuves, qui partageons ses victoires, et qui nous en réjouissons avec lui et pour lui. Et à la fin de chacune de ces émissions, chaque téléspectateur peut se dire : Cendrillon, c’est moi. Et si je le veux assez fort, moi aussi je peux devenir la Reine Margaux.
Création : de la profondeur à la surface
par Jean-Pierre Martinez, sémiologue, Juin 2006
La démarche analytique (au sens large) descend de la surface du discours jusqu’au sens profond qu’il manifeste, afin d’identifier une structure logique. Ainsi, le psychanalyste écoute le discours de son patient et tente d’en abstraire un système de pensée, expliquant un mode de vie, caractérisé par la reproduction de schémas, que la cure rend prévisibles et dès lors évitables.
La démarche créative, en revanche, remonte de la profondeur du sens à la surface du discours qui l’exprimera, par un certain nombre de paliers successifs, du plus abstrait (un concept, un thème, un sujet…) au plus concret (un roman, une pièce, un film…). Ainsi, un artiste trouvera dans son inconscient, ses traumatismes, ses fantasmes, voire parfois sa folie, la source d’inspiration pour une oeuvre, dotée par là même d’une certaine cohérence. On peut définir ainsi les principaux paliers de la création :
– Le système de valeurs : A ce premier stade, on définit une opposition de valeurs très générale et très abstraite, constituant une «axiologie». A partir du moment où un sujet plaque sur cette axiologie objective une appréciation subjective en distinguant les valeurs répulsives des valeurs attractives, l’axiologie devient une idéologie, autrement dit un système de valeurs.
– La structure de l’histoire : La quête par ce sujet des valeurs attractives, à l’aide d’alliés, et ses efforts pour éviter les valeurs répulsives, par un affrontement avec des opposants, constitue une histoire, comprenant une situation de départ, un moment de crise et un dénouement (heureux ou malheureux selon que les valeurs atteintes sont positives ou négatives).
– La mise en scène : On donne à l’histoire un habillage figuratif plus concret (des personnages, un lieu, une temporalité). La même histoire peut ainsi mettre en scène des aristocrates ou des loubards, en Italie ou aux Etats Unis, il y a plusieurs siècles ou aujourd’hui. D’où, par exemple, les innombrables variations sur le thème de Roméo et Juliette (cf. West Side Story).
– Le point de vue : Il faut distinguer l’histoire (qu’est-ce qui s’est passé?) du récit (qui raconte, dans quel ordre, en distillant quelles informations). Les histoires se ressemblant parfois, c’est le point de vue spécifique qui constituera souvent le principal intérêt d’une oeuvre. Dans le cas d’un projet de film, on en arrive à ce stade à un scénario écrit.
– La réalisation d’une oeuvre : C’est à cette dernière étape, on ne peut plus concrète, qu’interviendra, dans le cas d’un film par exemple, le talent du réalisateur chargé de choisir le casting et le décor, de diriger les acteurs et l’équipe technique, de tourner le film et d’en faire le montage. C’est également à ce stade qu’apparaîtra la dimension purement esthétique.
Si les grands thèmes, universaux, et même les histoires, sont en nombre limité, la variété de leurs expressions possibles est infinie.
Nouveau roman
Je suis auteur de théâtre. Je n’ai pas vocation à écrire des romans, je n’ai aucun goût pour cela, et aucun talent non plus. Ce qui va sans doute de pair, car comme il serait fou de continuer à aimer les êtres qui nous méprisent, il est aussi plus sage de ne pas persévérer dans les disciplines où on n’a aucune chance de se distinguer. Le titre de ce petit article n’est pas donc destiné à annoncer un « nouveau roman » dont je serais l’auteur. Un ouvrage qui s’inscrirait dans une longue bibliographie, faisant suite à un précédent opus et annonçant discrètement, comme une promesse, le suivant. Ces quelques lignes ne sont qu’un modeste hommage, empreint de nostalgie, à ce courant littéraire initié dans les années cinquante, et qui prit fin deux décennies plus tard, sans avoir réellement de continuateurs. Inapte par nature à fonder un nouveau classicisme, le Nouveau Roman restera éternellement une maladie infantile contracté sur le tard par un genre littéraire déjà moribond. Et qui lui fut peut-être fatal. Quand il n’y a plus de courants littéraires, c’est la littérature qui stagne, et qui finit par croupir. Le Nouveau Roman, lui, aura toujours vingt ans. Comme ces artistes révoltés, morts prématurément de leurs excès, sans laisser derrière eux ni veuves ni descendance ni héritage. Par delà la beauté des œuvres, c’est cette quête de liberté qui à l’époque me fascina. La liberté de tout détruire pour tout reconstruire, afin de retrouver l’envie de créer encore et toujours. Le Nouveau Roman, c’est le roman sans le romanesque. La fin de l’histoire, dans tous les sens du terme. Ce courant d’une extrême vitalité, qui prétendait libérer le romancier de l’obligation de raconter une histoire, constitua en même temps le dernier mouvement littéraire digne de ce nom par sa radicalité, mettant ainsi au moins provisoirement fin à l’histoire de la littérature. J’ai cessé de lire des romans quand le Nouveau Roman a rendu son dernier soupir. Et quand j’ai cessé de lire des romans j’ai commencé à écrire du théâtre.
