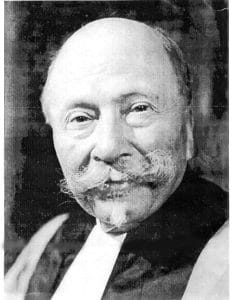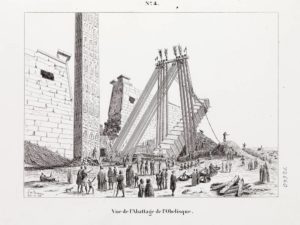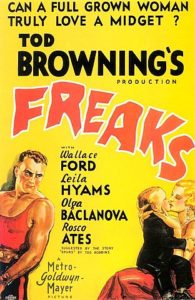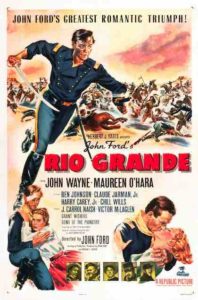Le Gaffiot
À Paris, j’ai retrouvé mon studio de la rue Daguerre, mais je n’ai plus de boulot et donc plus de revenus. Les quelques dollars que je rapporte du Texas pourront me permettre de tenir quelques mois, en vivant très modestement. En revanche, n’ayant pas travaillé en France depuis plus de deux ans, je ne suis plus inscrit à la Sécurité Sociale. Comme j’ai démissionné de mon poste à Ipsos avant de partir en Amérique, je ne peux pas non plus prétendre à des indemnités de chômage et à la couverture sociale qui va avec.
Pour l’administration française, ces deux années aux États-Unis n’existent pas. À moins de redevenir très rapidement salarié, je suis en passe de devenir un marginal. Je vis désormais dans l’angoisse d’un problème de santé imprévu entraînant des frais importants qui ne seraient pas pris en charge.
Du travail, pourtant, je n’en cherche pas dans l’immédiat. À trente-trois ans, toutes expériences cumulées, je n’ai pas travaillé plus de trois ans comme salarié dans un bureau, et jamais très longtemps dans la même entreprise. J’ai bien l’intention de ne plus jamais avoir à le faire et, même si je ne sais pas encore comment, j’y parviendrai. Il me faudra cependant recommencer à gagner ma vie, et je suis prêt à accepter des missions en free-lance comme sémiologue publicitaire, pourvu que je puisse faire ce travail chez moi et qu’on ne me demande pas d’aller pointer tous les matins dans un bureau, de devoir bavarder avec des collègues à la machine à café, d’obéir à un patron et de servir des clients. Je vis le monde de l’entreprise comme un univers carcéral. Aux États-Unis, j’ai fait l’expérience de la liberté, et je n’y renoncerai jamais.
Le retour dans la grisaille et l’anonymat parisien est évidemment un peu déprimant. Ici, je ne connais plus grand monde. Mais me lever chaque matin en sachant que je peux faire de ma journée ce que je veux est un luxe qui n’a pas de prix. J’ai plus que jamais soif d’apprendre et de rencontrer. Et quel meilleur endroit pour cela, encore et toujours, que l’université ?
Même si à mon grand regret, aux États-Unis, je n’ai pas aussi bien appris l’anglais que je l’aurais souhaité, j’ai tout de même fait quelques progrès. J’éprouve le besoin de structurer un peu la connaissance toute pragmatique que j’ai de cette langue, et d’aborder aussi la littérature anglo-saxonne en version originale. Je me réinscris à la Sorbonne pour réitérer en anglais la prouesse que j’ai déjà accomplie quelques années plutôt en espagnol.
Cette fois, j’intègre directement la troisième année et, juste revanche de mon humiliant échec au TOEFL deux ans auparavant, j’obtiendrai en neuf mois une licence avec mention très bien. Évidemment, mon approche des études est très différentes de celle des autres élèves, principalement des filles par ailleurs. Elles sont là pour obtenir un diplôme en se contentant de recracher le jour de l’examen des cours parfois pris sous la dictée. J’assiste seulement aux cours qui m’intéressent, je ne prends aucune note, et je dévore tous les bouquins de la bibliothèque où je suis très assidu.
Pour avoir le temps de remonter la pente, car je pars de très bas, j’ai renoncé au contrôle continu et tout misé sur l’examen final. Quelle jouissance de pouvoir lire tous les chefs d’œuvres de la littérature anglaise et américaine dans la langue où ils ont été écrits ! Comme je n’assiste qu’aux cours les plus passionnants, je ne m’ennuie pas une seule seconde. Pour ce qui est des autres cours, je regarde vaguement le programme, mais je ne demande jamais à mes camarades de me passer leurs notes. Je me contente de lire tout ce qui existe sur le sujet.
Au-delà de ces satisfactions purement intellectuelles, la Sorbonne est aussi le lieu idéal pour rencontrer des filles. J’ai une dizaine d’années de plus qu’elles maintenant. Assez pour que cela se voit, mais pas suffisamment pour risquer de passer dans l’immédiat pour un pervers. Je rencontre beaucoup de monde, et j’ai quelques nouvelles aventures, toujours sans grand lendemain.
Ma licence d’anglais en poche, je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie, et comment échapper durablement au salariat. J’ai repris quelques missions en free-lance, mais je ne veux pas réintégrer une entreprise. Pourquoi pas l’enseignement ? Après mon expérience idyllique à l’Université d’Austin, j’ai du mal à m’imaginer devant une classe dans un lycée de banlieue. Ce sera l’agrégation ou rien. Je m’inscris en préparation pour l’agrégation de lettres modernes à la Sorbonne.
Finalement, ce ne sera rien. Je me rends tout de suite compte que cette prépa n’est qu’un effroyable bachotage. Les cours sont désespérément inintéressants. Nos prétendus maîtres à penser sonnent creux. Les aspirants professeurs font déjà allégeance au système en se montrant totalement soumis. On s’efforce de nous prouver combien les génies que nous étudions sont incompréhensibles et inégalables, au lieu de nous encourager à les imiter à notre façon. On en fait des divinités à adorer au lieu d’en faire des modèles à ne pas suivre. C’est pourquoi l’école produit autant de professeurs et si peu d’écrivains. Tant d’esclaves et si peu d’affranchis. Bref, la méthode que j’ai appliquée pour obtenir mes licences d’espagnol et d’anglais ne peut pas fonctionner cette fois. Il faut prendre les cours en note mot pour mot et les apprendre par cœur, même s’il s’agit d’un tissu d’âneries, afin de pouvoir les restituer servilement le jour du concours. Tout cela donne du monde de l’enseignement une image tellement vaine, triste et liberticide. Toute ma vie est une quête de la liberté, et notamment de la liberté de penser. Plutôt crever que d’être professeur, même agrégé, et avoir pour mission d’enseigner à mes élèves la servitude.
Pour aller au bout de ma démarche, je passerai néanmoins les épreuves écrites. Ma meilleure note sera en latin. Un sept sur vingt, je crois, qui correspond à la moyenne générale pour l’admissibilité à l’oral. Dire qu’on m’a fait arrêter le latin en cinquième parce que je n’étais pas assez bon élève, et que j’ai passé le concours sans le Gaffiot auquel nous avions droit, et dans lequel figurait la traduction de deux ou trois phrases de la version sur laquelle nous avions à plancher…
Je ne serai donc pas enseignant. Mais que vais-je bien pouvoir faire de ma vie ? Une idée commence à germer en moi. Faire ce que l’école et la société se sont appliquées à m’interdire depuis mon enfance : écrire ma vie.